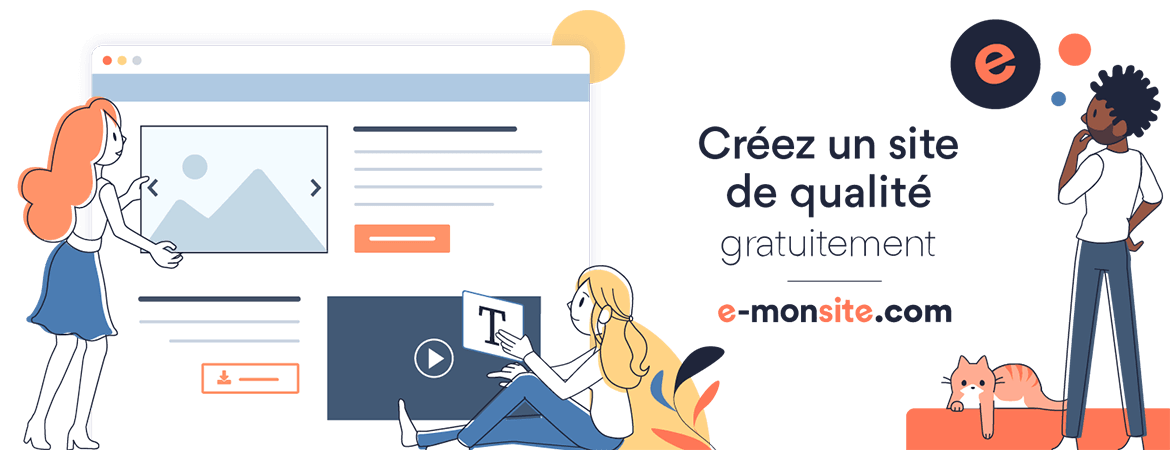A l’origine, l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) précise que « toute personne, en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu des ressources de chaque pays ».
En 1982, lors de la conférence mondiale sur les politiques culturelles de Mexico il est établi que « la culture dans son sens le plus large est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social ». Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.
En 2001, la Déclaration universelle de l'Unesco sur la diversité culturelle fut l'occasion pour les pays de réaffirmer leur conviction que la protection de la diversité culturelle est le meilleur gage de paix pour éviter les conflits entre cultures et civilisations.
En 2005, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, réaffirme les principes établis lors des déclarations précédentes et mentionne que « la « diversité culturelle » renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression. […] La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, enrichi et transmis grâce à la variété des expressions culturelles, mais aussi à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies utilisées »
Les droits culturels sont revendiqués par la "Déclaration de Fribourg" (2007), texte d'un collectif indépendant (le Groupe de Fribourg) coordonné par Patrice Meyer-Bisch (Coordonnateur de l’institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l'homme et de la Chaire UNESCO pour les droits de l'homme et la démocratie de l’Université de Fribourg et fondateur de l’Observatoire de la diversité et des droits culturels (organisme non gouvernemental). Cette Déclaration rassemble et explicite ce que seraient les droits culturels selon ce groupe. Cette déclaration propose une définition de la culture qui met l'identité individuelle au centre de cette dernière, en invoquant le principe de dignité humaine. Le terme « culture » recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, les institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu’il donne à son existence et à on développement. (Article 2a). La notion de culture dans les droits culturels n’est donc pas restreinte aux arts mais c’est ce qui permet aux personnes de donner sens à leur existence. Cette déclaration n'a pas de valeur juridique.
En 2015, les droits culturels existent juridiquement avec l’introduction de cette notion dans l'article 103 de la loi NOTRe. Il y est précisé que « la responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 » où apparaît l'expression "droits culturels".
La Loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au Patrimoine adoptée le 7 juillet 2016 réaffirme cette existence en mentionnant à l’article 3 que « l’Etat, […], les collectivités territoriales […] définissent et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels énoncés par la convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, une politique de service public construite en concertation avec les acteurs de la création artistique. »